Pierre* est aveugle. Il a perdu la vue très tôt et cela a lourdement impacté son intégration dans la société. Dans ce récit à la première personne, où il peine par moments à prendre de la distance avec son histoire, Pierre* raconte ses difficultés à suivre ses rêves à cause de son handicap.
« J’ai apprécié cette session singulière que j’ai trouvée au fond fondamentale. Il y a quelque chose que l’on reproche souvent aux journalistes : rester trop froid, trop lointain, garder ses distances avec ce que l’on évoque et même donner l’impression parfois que ça ne nous concerne pas. Aller chercher au fond de nous-mêmes une histoire qui fait partie de notre parcours, de notre existence et le raconter en notre propre nom, j’ai trouvé ça formateur. Ça m’aide aujourd’hui à écrire au « nous » dans mes papiers, à m’inclure naturellement. Je ne crois pas que j’aurais eu la même démarche sans cette formation. » Pierre*
*Par soucis d’anonymat, le prénom a été modifié.
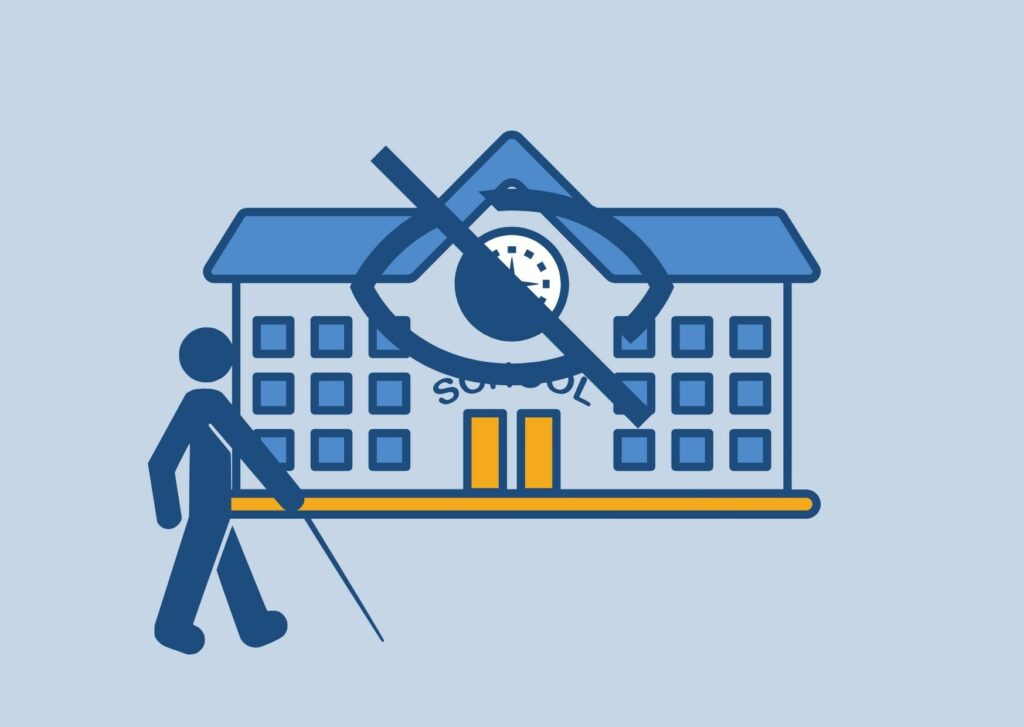
Un long chemin vers la liberté
Nous vivons au XXIe siècle. Et pourtant, en France, l’insertion des personnes à mobilité réduite en milieu ordinaire ne coule pas de source. La loi sur le handicap de 2005 a permis aux institutions de faire des progrès. Mais ils restent insuffisants et le combat pour l’intégration continue.
« Longtemps, je me suis couché de bonne heure. » Je m’allongeais non pas pour penser ce que je venais de lire ou de voir, à l’instar de Marcel Proust, mais bien par obligation. Je n’étais pas à la recherche du temps perdu, mais j’oubliais de me servir du temps. Entre un lapin et un ourson en peluche, je me glissais sous les draps peu après vingt heures. J’appelais mes parents peut-être parce qu’ils me manquaient, sans doute parce que je n’avais rien à faire d’autre. Je grignotais des boudoirs et mettais des miettes partout que je balayais d’un revers de main. Je partageais des boîtes de Tictac avec un ou deux camarades qui cohabitaient dans cette petite pièce d’un dortoir du septième arrondissement de Paris.
Surtout, j’allumais la radio. J’écoutais des matchs de foot, des conteurs lire des histoires, des débats d’actualité et toutes sortes d’émissions pendant des heures. Sur les murs de ma chambre, je voyais danser les acteurs de ce que j’entendais : tantôt en se lançant des ballons, tantôt en mimant des gestes d’agacement ou de ravissement. J’en écrivais parfois des articles. Ma passion du journalisme grandissait. Mais je m’ennuyais prodigieusement dans un monde parallèle.
« J’ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies,
Baiser montant aux yeux des mers avec lenteurs,
La circulation des sèves inouïes,
Et l’éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs ! »
Mes parents avaient décidé de me confier à des instituts pour aveugles après ma perte de vue l’été précédant mon entrée en CP. Les écoles des Yvelines où nous résidions refusaient de m’accueillir, arguant qu’elles en avaient ni les moyens, ni le temps. Elles en avaient à l’époque encore le droit.
Si ma primaire, dans une école hors contrat mise à disposition par des sœurs catholiques, m’avait ouvert aux sports, aux arts, aux activités manuelles et à l’expression collective, ma fugue forcée vers le public et le réputé institut national des jeunes aveugles (INJA) m’a littéralement renversé.
Le cauchemar de l’internat pour aveugles
« Moi qui tremblais, sentant geindre à cinquante lieues
Le rut des Béhémots et les Maelstroms épais,
Fileur éternel des immobilités bleues,
Je regrette l’Europe aux anciens parapets ! »
J’étudiais au collège et j’y dormais la nuit. Je vivais dans cet internat autarcique au cœur du riche boulevard des Invalides. Là, entre le prestige de l’Hôtel des Invalides et la vitalité du quartier Montparnasse, je tournais en rond. Je mangeais mal. Dans le tumulte du dortoir, j’angoissais. Je ne parvenais pas à travailler correctement. Parfois, les surveillants hurlaient contre les excités qui inondaient les salles de bain en faisant des cris d’animaux. Souvent, ces veilleurs de nuit préféraient se calfeutrer dans leur chambre pour réviser leurs partiels. Le bazar continuait. Il arrivait que de jeunes téméraires lancent des pétards ou bloquent des serrures avec des chewing-gums. Je ne demeurais pas dans un internat de demeurés, mais dans un internat normal. Enfin, un internat d’élèves qui n’y voyaient pas grand-chose.
C’était ça, le pire. Vivre parmi les aveugles et ne connaître qu’eux. Sans compter que tout le monde n’avait pas la chance de cultiver des liens familiaux. Heureusement, mes origines portugaises font que la famille reste le socle de la vie quoi qu’il arrive. Mais en ne vivant qu’avec des aveugles, je pensais que mes parents et grands-parents, mes oncles, tantes et cousins restaient à mon service. Je vivais dans une parfaite illusion. Une dangereuse allégorie de la vie qui me donnait à voire des reflets de songe. Je grandissais dans un cocon douillet. Je m’étouffais. Je ne me rendais pas compte que je ne respirais plus et je n’imaginais pas un seul instant ce que voulais dire l’intégration.
J’aimais une aveugle, je n’avais que des camarades aveugles, j’avais des professeurs aveugles ou malvoyants et des chiens guide cavalaient dans tout l’établissement. L’intégration était un gros mot. Personne ne nous engageait sur cette voie. « On était en prison à l’INJA », confirme Lucas Chevalet qui était dans ma classe jusqu’en quatrième. « On n’avait pas le droit de sortir et il était hors de question d’imaginer aller dans un collège ordinaire. On n’avait aucune perspective. On croupissait là comme des souris à bouffer de la merde. On n’avait pas le droit de lever le petit doigt. Il fallait étudier comme un petit soldat. » Beaucoup se faisaient exclure, par manque d’autorité, fugue ou refus de participer à telle ou telle activité. Les dommages aux biens ou personnes restaient souvent impunis. Alors on se soumettait. Tenu par la propagande de l’Institut, on imaginait que l’INJA demeurait la seule voie pour s’en sortir. Réussir, peut-être pas, il ne fallait pas exagérer. Les taux de réussite aux examens nationaux de l’Institut dégringolaient à l’époque. Mais faire quelque chose de notre vie, même si on n’avait aucun projet.
Le difficile combat vers l’intégration
« La tempête a béni mes éveils maritimes.
Plus léger qu’un bouchon j’ai dansé sur les flots
Qu’on appelle rouleurs éternels de victimes,
Dix nuits, sans regretter l’œil niais des falots ! »
Moi, je voulais devenir journaliste. « C’était mon rêve », expliquait Jean-Pierre Foucault. Alors je rêvais de faire comme Oscar Wilde : viser la lune pour atterrir dans les étoiles. J’apprenais à perfectionner mon style. J’écrivais des poèmes. Je rédigeais des articles et je travaillais ma voix sur des commentaires sportifs improvisés. D’avenir cependant, je n’avais toujours point. Je restais enfermé dans cet établissement infâme en compagnie des aveugles. J’avais l’impression d’être une bête de foire mise en scène dans un zoo. J’ignorais comment j’allais finir. Mais je voulais me prendre en main.
En quatrième, j’ai explosé. Je n’avançais pas. Je ne faisais plus mes devoirs. J’ai décidé de forger mon caractère et de me faire violence. Partir, fuir, m’intégrer pour découvrir et comprendre le monde qui m’entoure et faire du handicap une force. Je ne savais pas ce qui allait m’attendre. Mais je connaissais ma détermination. Je ne désirais qu’une seule chose : décamper et tout abandonner.
« Or moi, bateau perdu sous les cheveux des anses,
Jeté par l’ouragan dans l’éther sans oiseau,
Moi dont les Monitors et les voiliers des Hanses
N’auraient pas repêché la carcasse ivre d’eau »
Lorsque j’ai commencé à évoquer mon projet, l’administration m’a tout de suite mis des bâtons dans les roues. Les éducateurs m’ont rétorqué que je ne savais pas me déplacer. C’était vrai. Nous manquions de professeur de locomotion et je venais à peine d’obtenir un cours. Je manquais d’assurance et je n’avais pas encore assimilé tous les codes. Les professeurs m’expliquaient que je n’allais pas suivre le rythme. Je performais en dactylographie, mais je n’avais jamais eu de cours d’informatique. L’administration m’accusait de désocialisation et refusait de me laisser intégrer un collège ordinaire.
J’en pouvais plus. La directrice des enseignements n’avait pas tort. Je me morfondais comme jamais. J’avais rompu avec ma petite amie aveugle et je m’éloignais des autres. Je ne les supportais plus. Ces aveugles qui ne faisaient attention à rien, qui ne se voyaient aucun avenir et qui demeuraient plantés là, au milieu des couloirs, perdus dans leur musique, me paraissaient étrangers. Alors j’ai doucement disparu. J’ai rasé les murs. Progressivement, j’ai déserté la cantine et je me suis renfermé. J’ai préféré m’enfermer avec moi-même plutôt que d’accepter la soumission à cet établissement qui fait du handicap un fardeau et qui nous empêche de le porter. On m’a surnommé le fantôme.
Les éducateurs ont continué à me faire des procès d’intention. Mes résultats scolaires ont progressivement baissé, même si je restais toujours le meilleur de ma classe. Les quelques élèves envoyés en intégration cette année là ont tous échoué. Eux y voyaient la preuve de mon échec programmé. Il faut dire qu’ils n’incitaient des élèves à franchir le cap sans vraiment se soucier s’ils se figuraient les difficultés à venir. Souvent, ils n’étaient pas prêts mentalement à affronter la réalité d’une vie où le handicap reste un obstacle et parfois un virus que l’on croit contagieux. Ceux qui se sentaient prêts ne faisaient même pas l’objet d’un accompagnement digne de ce nom et restaient sur le carreau. En ce qui me concerne, personne ne s’est risqué à m’encourager dans mon combat. Je n’ai pas pu soutenir ma cause lors des conseils de classe, je n’étais pas délégué. Curieusement, c’est mon ancienne petite amie qui m’a défendue. Ma mère a écrit des courriers, personne ne l’a jamais reçu. J’étais tout seul dans l’établissement à pédaler dans la semoule. J’ignorais si mes efforts allaient porter leurs fruits. Je restais dans le flou.
L’insoutenable incertitude
« Parfois, martyr lassé des pôles et des zones,
La mer dont le sanglot faisait mon roulis doux
Montait vers moi ses fleurs d’ombre aux ventouses jaunes
Et je restais, ainsi qu’une femme à genoux… »
Je m’en occupais guère, et mes parents non plus, mais à ce moment là une loi importante se votait sur les bancs de l’Assemblée et du Sénat. La législation de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées oblige désormais à rendre accessibles les lieux publics. Surtout, elle impose aux établissements scolaires d’accueillir et dans de bonnes conditions les élèves handicapés. « Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école de son quartier. Il pourra ensuite être accueilli dans un autre établissement, en fonction du projet personnalisé de scolarisation. Sont mis en place les équipes de suivi de la scolarisation et les enseignants référents. »
Je tenais dans ma manche un parfait argument. D’autant que l’institut, qui incarne le monde des élèves aveugles, est censé donner l’impulsion. J’ai continué alors à appuyer mes convictions jusqu’à la fin de l’année sans certitude. J’ai quitté la région parisienne pour me regonfler d’énergie au bord de l’océan tout l’été sans en savoir davantage. Le mur se dressait toujours aussi haut et froid devant moi. J’ignorais si j’avais finalement pu être affecté dans un collège parisien. Je voulais étudier à Molière, dans le 16E arrondissement. Mais je n’avais même pas pu réaliser de semaine d’essai comme c’est normalement le cas pour les élèves intégrés en milieu ordinaire. L’équipe pédagogique de l’INJA ne me donnait aucune indication. J’avais des crampes au ventre tout au long de l’été. Ce n’est que le 20 août que j’ai appris mon affectation dans le collège lycée de Buffon.
En gagnant une bataille, on n’a pas encore remporté la guerre
«J’ai heurté, savez-vous, d’incroyables Florides
Mêlant aux fleurs des yeux de panthères à peaux
D’hommes ! Des arcs-en-ciel tendus comme des brides
Sous l’horizon des mers, à de glauques troupeaux ! »
J’étais libre. C’est vrai, en quelque sorte. Mais lorsque vous appartenez à un établissement spécialisé aussi bouclé que celui-là, vous ne l’êtes jamais tout à fait. Je ne faisais qu’y dormir, mais l’institut me donnait toujours de fil à retordre. Je ne me trouve pas particulièrement paranoïaque, mais le suivi scolaire dans un milieu ordinaire n’est pas une fin en soi. Encore faut-il avoir les moyens de s’intégrer. Fin décembre, je n’avais toujours aucun livre en braille. La professeur de l’INJA qui me suivait ne respectait jamais les rendez-vous et m’accusait de manquer de sérieux. L’institut me faisait valoir ma dépendance de part l’assistance de transport que j’avais demandé pour me rendre au collège. Mes éducateurs me reprochaient de jamais participer aux activités de l’internat. Les autres élèves de l’institut me percevaient comme le vilain petit canard hautain. J’achevais ma désintégration dans le monde des aveugles en m’intégrant dans le monde réel.
« Dans les clapotements furieux des marées,
Moi, l’autre hiver, plus sourd que les cerveaux d’enfants,
Je courus ! Et les Péninsules démarrées
N’ont pas subi tohu-bohus plus triomphants. »
Textes du bateau ivre d’Arthur Rimbaud

